- ホーム
- > 洋書
- > フランス書
- > DROIT
- > Droit prive
- > Droit des affaires
基本説明
En présence d'un différend, comment résoudre celui-ci par la conclusion d'un accord destiné à se substituer au prononcé d'un jugement, qu'un juge soit ou non saisi, avec ou sans le concours d'un tiers conciliateur ou médiateur ? Depuis 1804, le législateur, sans opérer de distinction à cet égard, offre aux parties la faculté de recourir au contrat de transaction, régi par les dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil. Ceux-ci, quasiment inchangés pendant plus de deux siècles, ont été modifiés par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. En vue d'accroître la lisibilité du droit de la transaction et l'efficacité de ce mode de résolution, le législateur a notamment consacré l'exigence de concessions réciproques et abrogé la règle originaire qui excluait qu'une transaction puisse être annulée pour cause d'erreur de droit. Sans attendre ces évolutions, la recherche de solutions transactionnelles s'est accentuée dès le XXe siècle, et a généré deux champs de développement des modes négociés de règlement des différends. D'une part, le contrat de transaction a vu son régime se structurer par voie jurisprudentielle. L'exigence de concessions réciproques a suscité un volumineux contentieux, notamment sur le terrain des conflits individuels entre employeur et salarié. Ainsi la rupture de la relation de travail a-t-elle engendré un régime jurisprudentiel spécifique de l'admissibilité du recours au contrat de transaction, outre des attendus qui, de par leur généralité, ont vocation à former le droit commun.
-
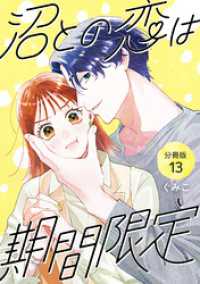
- 電子書籍
- 沼との恋は期間限定 【分冊版】 13 …
-

- 電子書籍
- 【デジタル限定】高崎かなみ写真集「魅惑…
-

- 電子書籍
- 貴族令嬢。俺にだけなつく【ノベル分冊版…
-

- 電子書籍
- 異世界に行ったら分裂してしまった【タテ…




